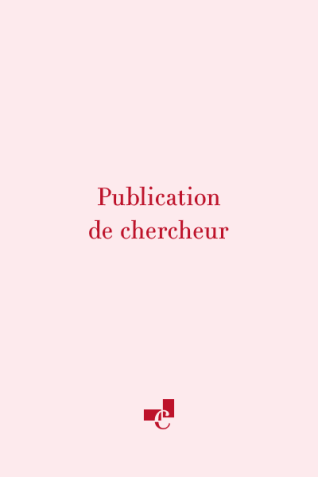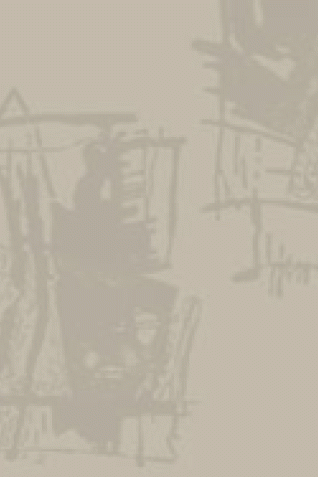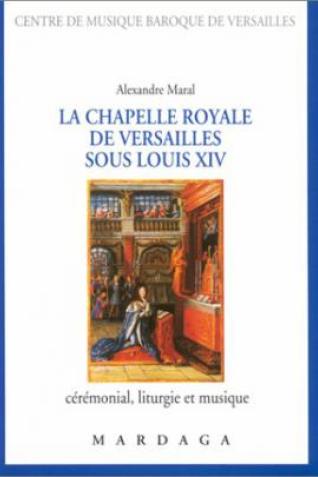La bataille de Malplaquet (1709). Perdre une bataille, gagner la guerre ?
Près de 190 000 hommes s’affrontent à Malplaquet le 11 septembre 1709, dans la plus sanglante bataille de la France d’Ancien Régime. Le soir, les Français abandonnent le terrain. Mais ont-ils vraiment perdu ? Comment cet échec tactique finit-il par ressembler à une victoire ?
L’année 1709 est la pire de tout le règne de Louis XIV. Engagé dans une guerre désastreuse, le royaume est financièrement, militairement et moralement épuisé ; et en janvier, le « Grand Hiver » plonge le pays dans la disette. En juin, les troupes adverses se lancent à l’assaut du royaume. L’armée française, désemparée et affamée, semble incapable de contrer l’invasion.
Le 11 septembre 1709, son chef, Villars, décide pourtant de faire face et d’attendre l’ennemi à Malplaquet, non loin de Valenciennes. Près de 190 000 hommes s’affrontent alors, dans la plus sanglante bataille de la France d’Ancien Régime. Le soir, les Français abandonnent le terrain. Mais ont-ils vraiment perdu ? La saignée a été beaucoup plus forte chez l’ennemi, dont le rêve de conquête rapide s’évanouit. Les organes de propagande de Louis XIV arrivent à peindre le revers sous des traits flatteurs. Progressivement, sous l’effet des luttes politiques qui minent le clan adverse, la défaite française se mue en succès ; et la guerre arrive à un point de bascule.
Comment cet échec tactique finit-il par ressembler à une victoire ? Pour le comprendre, il faut décrypter les règles sous-jacentes des relations internationales et de la stratégie sous l’Ancien Régime. La bataille de Malplaquet, paroxysme de la violence de guerre, permet aussi d’étudier les mécanismes qui régissent les armées européennes à l’aube du Siècle des Lumières.
Partager sur les réseaux sociaux
À découvrir
Découvrez d'autres productions de l'École sur les mêmes thématiques.